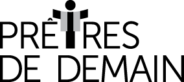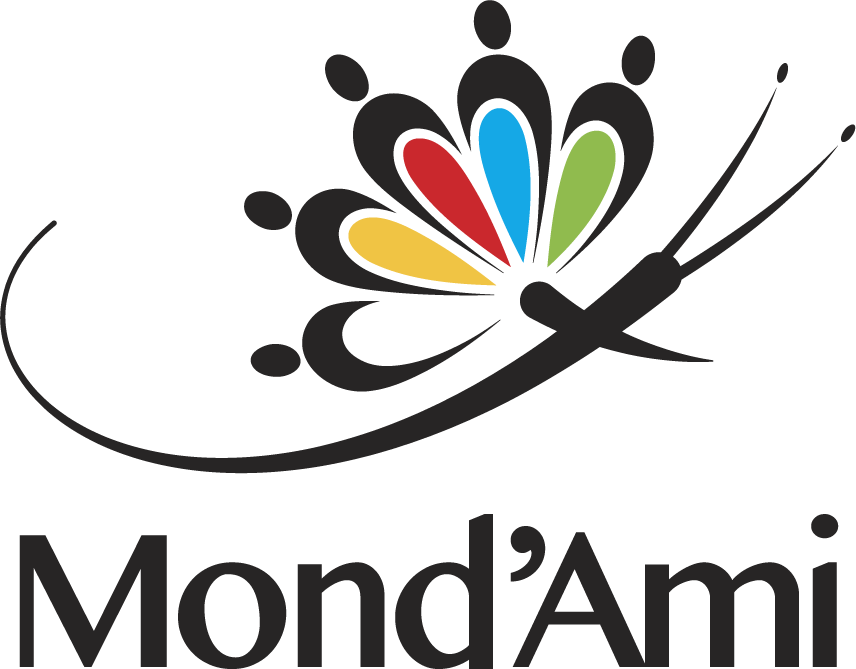06 Oct 2025
Cardinal Marengo : Murmurer l’Évangile au-delà de toutes les frontières et barrières
Par cardinal Giorgio Marengo, préfet apostolique d'Oulan-Bator, en Mongolie
Nous publions l’intervention * prononcée par le cardinal Giorgio Marengo, préfet apostolique d’Oulan-Bator, à l’occasion du Congrès missionnaire international « La Missio ad gentes aujourd’hui : vers de nouveaux horizons » **, qui s’est tenu dans l’après-midi du samedi 4 octobre dans l’Aula Magna de l’Université pontificale Urbanienne, dans le cadre du Jubilé du monde missionnaire et des migrants.
Je remercie les organisateurs de cette précieuse Conférence missionnaire internationale de m’avoir invité et de m’offrir la possibilité de partager quelques réflexions sur un thème plus que jamais important dans l’Église d’aujourd’hui. « Murmurer l’Évangile » exprime la profondeur, la complexité et la beauté de la Mission, en particulier celle de la première annonce. Je propose donc de partir précisément de cette expression pour développer avec vous une brève réflexion missionnaire.
C’était en 1998 : lors des travaux du Synode spécial pour l’Asie, l’archevêque de Guwahati, Mgr Thomas Menamparampil, s.d.b., partage cette expression avec les Pères synodaux. Souhaitant résumer la mission de l’Église en Asie, le prélat indien parle de « Whispering the Gospel to the Soul of Asia », c’est-à-dire « Murmurer l’Évangile à l’âme de l’Asie ». Après son intervention, dans la salle et dans les couloirs, nombreux sont ceux qui l’ont approché pour le féliciter de cette définition. En tant qu’Indien et expert de la Mission en Asie, Mgr Menamparampil avait su synthétiser l’essentiel de la Mission et sa polyvalence dans une image très évocatrice.
Le cœur de la Mission est certainement l’Évangile. Cela va sans dire, mais mieux vaut trop insister que pas assez : la mission de l’Église est toujours et partout d’offrir à chaque personne la possibilité de connaître le Christ et son Évangile. Ce trésor est destiné au cœur, à la partie la plus profonde et la plus mystérieuse de la personne. C’est pourquoi on murmure : c’est une action délicate, qui exige de la confiance, qui suppose une relation d’amitié sincère. Les paroles de saint Paul VI me reviennent à l’esprit, qui, au n° 20 de l’exhortation apostolique Evangelii nuntiandi, rappelait : « il importe d’évangéliser — non pas de façon décorative, comme par un vernis superficiel, mais de façon vitale, en profondeur et jusque dans leurs racines — la culture et les cultures de l’Homme, dans le sens riche et large que ces termes ont dans Gaudium et spes, partant toujours de la personne et revenant toujours aux rapports des personnes entre elles et avec Dieu ».
Murmurer l’Évangile vient du cœur et s’adresse au cœur. Marie-Madeleine court informer les disciples du tombeau vide et de la rencontre avec le Ressuscité ; le cœur ardent des disciples d’Emmaüs désire partager la joie du Voyageur qui a dissipé les ténèbres de leur déception. Il y a donc une annonce ad intra qui anime la première communauté croyante et qui continue à la soutenir partout et toujours, jusqu’à nos jours ; mais dès le début, il y a aussi une annonce ad extra, tout comme le Ressuscité l’avait demandé aux onze : « Allez dans le monde entier. Proclamez l’Évangile à toute la Création » (Mc 16, 15, cf. Mt 28, 19-20). Saint Paul ne peut cacher le « mystère caché depuis les siècles » et l’annonce à la communauté de Colosses, composée principalement de païens.
Dans le contexte du Jubilé du monde missionnaire, il est important de revenir au don de la grâce et à la responsabilité qui en découle d’annoncer l’Évangile à ceux qui ne le connaissent pas encore. C’est là la spécificité de ce qu’on appelle la missio ad gentes, qui continue d’avoir aujourd’hui encore sa validité et sa nécessité.
Il est beau que nous nous le disions ici, à l’Université pontificale Urbanienne, héritière de l’ancien Collège Urbain fondé en 1627 précisément pour donner corps à cet engagement formatif et de recherche scientifique qu’exige la Mission. Il n’est pas superflu de rappeler ici que la Sacrée congrégation de Propaganda Fide a été créée précisément pour ramener au cœur de l’Église la noble tâche d’annoncer l’Évangile là où il n’était pas encore connu, après que les puissances coloniales de l’époque s’en soient chargées, non sans mérites et qualités, mais aussi avec des limites et des faiblesses inévitables. Si, à l’époque, il s’agissait de « purifier » l’engagement missionnaire en le ramenant sous l’égide du Siège apostolique, il semble qu’aujourd’hui, il s’agisse de reconfirmer la validité de cet engagement spécifique, parfois remis en question, comme s’il n’avait plus sa raison d’être dans un monde globalisé et de plus en plus interconnecté. Cette subtile ambiguïté avait déjà été mise en évidence par saint Jean-Paul II qui, en 1990, avait jugé nécessaire de réaffirmer la « validité permanente du mandat missionnaire » dans la lettre encyclique Redemptoris missio. On entrevoit ainsi une ligne magistérielle qui part de la constitution conciliaire Ad Gentes, passe par l’exhortation apostolique Evangelii nuntiandi de saint Paul VI déjà citée et est confirmée par saint Jean-Paul II avec l’encyclique Redemptoris missio ; elle est précisée davantage dans les documents de la Congrégation pour la doctrine de la foi, notamment dans la déclaration Dominus Jesus de 2000 (signée par le cardinal Joseph Ratzinger) et dans la Note doctrinale sur certains aspects de l’évangélisation de 2007 ; l’exhortation apostolique post-synodale Verbum Domini du pape Benoît XVI (2010) contient un encouragement clair à l’importance de la mission ad gentes, en soulignant son importance essentielle ; enfin, l’exhortation apostolique Evangelii gaudium du pape François vient confirmer et relancer l’engagement inchangé de l’Église dans l’annonce joyeuse de l’Évangile, replacée au centre de la vie et de la mission de l’Église, y compris dans son organisation centrale, comme le réaffirme la Constitution apostolique Praedicate Evangelium (2022).
D’ailleurs, c’est l’expérience de l’Église depuis ses débuts. Saint Paul ne pouvait concevoir sa vocation en dehors de l’annonce : « Malheur à moi si je n’annonçais pas l’Évangile ! » (1 Co 9, 16). Grâce à lui surtout, le Collège des Apôtres prit conscience, au cours de ces mêmes années, que le mandat reçu du Ressuscité concernait certes le peuple de l’Ancienne Alliance, mais aussi les nations issues de traditions religieuses distinctes et qui représentaient la majorité du monde de l’époque. Si nous nous identifions un instant aux premières générations chrétiennes, juste après la Pentecôte, nous nous retrouverions dans un monde qui était entièrement non chrétien (et en grande partie non juif) ; et c’est précisément à ce monde que les premiers croyants, guidés par les Apôtres, se sentaient envoyés pour partager la joie de l’Évangile. La norme était d’entrer en contact avec ceux qui ne connaissaient pas du tout Jésus-Christ, et c’est de là qu’est née et s’est enracinée la conviction aimante de vouloir le faire connaître.
Proposer aujourd’hui la mission ad gentes, c’est repartir de là, avec amour et délicatesse, en souhaitant murmurer l’Évangile au cœur de chaque personne et de toutes les cultures. Cette tension amoureuse orientée vers la communication de l’Évangile suscite un enthousiasme sincère pour les cultures et un engagement rigoureux à les déchiffrer, en en saisissant les traits les plus essentiels. Au fil des siècles, nous nous étions habitués à un contexte de connaissance répandue du christianisme ; deux mille ans de mission, ce n’est pas rien ! Pourtant, même si c’est dans une mesure limitée, il existe encore aujourd’hui des réalités où le Christ et son Évangile ne sont pas encore connus et où les possibilités concrètes de s’y confronter sont rares, faute de témoins sur place. C’est dans ces réalités que se vit principalement la mission ad gentes. Voici donc une manière de la décrire, selon un critère ecclésiologique : être là où l’Église visible n’est pas encore présente ou ne l’est que de manière incomplète. Il est important d’en prendre acte et de redécouvrir la beauté de cette phase initiale de rencontre de l’Évangile avec des groupes humains et des cultures qui, pour diverses raisons, n’y avaient pas encore été confrontés. Cela aide à maintenir la fraîcheur de la première annonce, capable de déclencher un processus en chaîne qui vivifie la transmission de la foi dans toute l’Église, même là où elle est déjà constituée. Les expériences des Églises particulières encore en phase d’insertion, caractérisées par une condition minoritaire par rapport aux sociétés humaines dans lesquelles elles se trouvent, ont ceci de beau : malgré leurs limites évidentes, elles rappellent à l’Église universelle l’essentiel de son identité profonde, c’est-à-dire qu’elle existe pour l’annonce du royaume de Dieu, et non pour elle-même.
Le témoignage des croyants des premières générations a quelque chose d’unique et de contagieux, comme le remarquent les journalistes et les écrivains qui recueillent leurs témoignages. Dans le cas de la Mongolie, le succès éditorial récemment remporté par Javier Cercas avec son livre « Le fou de Dieu au bout du monde » est assez emblématique. Un reportage encore plus directement lié au témoignage des premiers catholiques en Mongolie est celui réalisé par Marie-Lucile Kubacki De Guitaut, dans son livre « Jésus en Mongolie ».
Otgongerel Lucia est un exemple lumineux : née avec un handicap physique grave (absence de la partie terminale des membres supérieurs et inférieurs), une fois qu’elle a embrassé la foi, elle a voulu s’engager dans des initiatives d’aide solidaire, d’abord comme bénévole, puis comme employée permanente. Aujourd’hui, elle gère la Maison de la Miséricorde d’Oulan-Bator, une structure inaugurée par le pape François en 2023 et destinée aux personnes en difficulté, auxquelles elle offre de la nourriture, des soins médicaux et des conseils.
Pour accompagner les premiers pas de l’Église qui s’implante dans un territoire donné, il est essentiel d’affiner les outils permettant de connaître son identité culturelle et d’entrer en dialogue avec elle, afin de favoriser une croissance inculturée de la foi. Là encore, le rôle des personnes natives est essentiel. Selenge Ambrogio, homme d’affaires et orientaliste expert, ressent la vocation de « garder la porte ouverte pour laisser entrer la lumière ». En tant qu’homme cultivé et expert en dynamiques interculturelles, il est conscient de la complexité de l’annonce évangélique et du temps qu’elle requiert ; cela ne l’empêche pas de s’acquitter de la délicate tâche de favoriser la Mission, en mettant ses compétences à disposition pour encourager ceux qui sont en quête et promouvoir la rencontre de l’Évangile avec la culture mongole. Et nous avons commencé avec lui il y a quelques jours un parcours sudiu, pour aider nos séminaristes à connaitre la beauté et la richesse de la culture mongole.
Enkhtuvshin Agostino est le seul artiste catholique mongol. Titulaire d’un doctorat en sculpture de l’Académie des Beaux-Arts de Moscou, il a commencé à collaborer avec les premiers missionnaires catholiques arrivés entre-temps dans son pays natal à son retour. Dans son enseignement universitaire et à travers sa production artistique, il offre des clés de lecture importantes pour le partage de la foi.
Murmurer l’Évangile au cœur d’une culture encourage une évangélisation discrète et attentive aux détails, dans la conscience que son dynamisme est celui de l’attraction plutôt que du prosélytisme. En filigrane, on entrevoit la profondeur comme concept central de la Mission. Tout un monde culturel qui s’ouvre à l’Évangile exige de la délicatesse, de la patience et surtout de la profondeur, celle que la dimension priante et contemplative est capable de préserver. L’étude, la charité et la prière s’entremêlent dans une expérience caractérisée par la discrétion et la persévérance. « Le missionnaire doit être un « contemplatif en action ». … S’il n’est pas contemplatif, il ne peut annoncer le Christ de manière crédible. Il est témoin de l’expérience de Dieu et doit pouvoir dire comme les Apôtres : « Ce que nous avons contemplé, c’est-à-dire le Verbe de la vie…, nous vous l’annonçons » (1 Jn 1, 1-3) ». Cette citation de Redemptoris missio (n° 91) rappelle le lien profond qui existe entre la vie contemplative et la mission évangélisatrice sur les routes du monde. Accepter la vocation à la mission ad gentes – car il s’agit bien d’une vocation spécifique au sein de l’Église – permet de découvrir la nécessité incontournable de s’adapter toujours davantage au style choisi par le Christ pour se manifester au monde. Le pape Léon XIV l’a résumé dans une récente catéchèse :
« Le centre de notre foi et le cœur de notre espérance sont fermement enracinés dans la résurrection du Christ. En lisant attentivement les évangiles, nous réalisons que ce mystère est surprenant non seulement parce qu’un homme – le Fils de Dieu – est ressuscité des morts, mais aussi pour la manière choisie pour le faire. En effet, la résurrection de Jésus n’est pas un triomphe pompeux, ce n’est pas une revanche ou une vengeance contre ses ennemis. C’est le merveilleux témoignage de la capacité de l’amour à se relever après une grande défaite pour continuer son irrépressible chemin […] Sorti des enfers de la mort, Jésus ne se venge pas. Il ne revient pas avec des gestes de puissance, mais manifeste avec douceur la joie d’un amour plus grand que toute blessure et plus fort que toute trahison. Le Ressuscité n’éprouve aucun besoin de rétablir ou d’affirmer sa supériorité. Il apparaît à ses amis – les disciples – et il le fait avec une extrême discrétion, sans les forcer leur capacité à l’accepter. Son unique désir est d’être à nouveau en communion avec eux […] ».
Vécue comme un murmure de l’Évangile au cœur d’une culture donnée, la mission ad gentes se décline en une multitude de manifestations extérieures, correspondant aux nombreux domaines dans lesquels elle se concrétise. Il existe toutefois une racine profonde, pas toujours visible, qui soutient chaque action extérieure et résiste même en son absence. En retenant la définition de la mission ad gentes proposée ici, on peut dire que la raison de la présence du missionnaire dans certains contextes humains est de « proclamer l’Évangile » ; une expression typique de notre lexique intra-ecclésial, mais qui nécessite une explication. Déjà dans le Nouveau Testament, cette expression est devenue une formule condensée pour désigner une réalité complexe et multiforme. Le mot « Évangile » lui-même est un résumé, une tentative d’exprimer en un seul mot quelque chose d’extrêmement vaste et beau. Le but est de mettre les gens en contact avec le Christ, de le faire connaître et aimer, surtout là où cette possibilité est rare. La question à se poser est donc la suivante : comment évaluer son travail missionnaire quotidien ? Quelle est la qualité de l’annonce proposée ? Ou, plus fondamentalement encore, y a-t-il une annonce dans notre travail missionnaire ? Y a-t-il l’Évangile ? Bien sûr, on pourrait dire : « Tout est Évangile, tout sert à la Mission, tout y contribue ». En sommes-nous vraiment sûrs ? Essayons d’être honnêtes…
On a l’impression que même dans une situation véritablement ad gentes, une fois que nous sommes installés, que nous avons trouvé notre place, notre « bureau » d’où nous nous sentons importants, nous finissons par entrer dans un mécanisme qui nous fait agir comme des missionnaires, avec toute une série de « choses à faire », mais parfois sans cette profondeur, cette intentionnalité qui font toute la différence. En réalité, évangéliser est quelque chose de beaucoup plus profond et encore plus beau. C’est vivre notre relation personnelle avec le Christ à un niveau si vital qu’elle se répercute ensuite dans notre vie quotidienne, quelle qu’elle soit. Ainsi, nos expériences peuvent être très variées, elles peuvent (et dans certains cas doivent) même changer, à condition qu’au fond de nous, il y ait cette relation vivante avec le Christ, seul Grand prêtre, seul vrai Pasteur, Frère universel. Si cette dimension fait défaut, nous sommes vraiment à plaindre. Quelle vie misérable, sans ce feu des disciples d’Emmaus.
Nous entrevoyons alors une dimension que nous pourrions définir comme « générative » de la Mission. Les personnes consacrées sont appelées à la paternité et à la maternité spirituelles. Il ne suffit pas qu’un père ou une mère travaille, s’engage pour garantir l’éducation, la santé et les opportunités à ses enfants ; il doit aussi porter en lui leurs crises, accepter les refus, les oppositions, les protestations et les échecs. Ce n’est que lorsqu’un père ou une mère explore ce mystère de ses enfants, en l’approfondissant, en présentant tout à Dieu dans la prière, qu’il devient vraiment génératif, fécond. En d’autres termes, vivre véritablement la vocation missionnaire ad gentes implique une participation intime au mystère du Christ, envoyé par le Père pour le salut de tous. C’est là sa dimension la plus profonde et la plus nécessaire, capable de rendre fécondes les œuvres extérieures. Ici aussi, le maître est saint Paul. Il décrit ainsi son ministère missionnaire : « Mais nous, les Apôtres, il me semble que Dieu nous a exposés en dernier comme en vue d’une mise à mort, car nous sommes donnés en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous, nous sommes fous à cause du Christ, et vous, vous êtes raisonnables dans le Christ ; nous sommes faibles, et vous êtes forts ; vous êtes à l’honneur, et nous, dans le mépris. Maintenant encore, nous avons faim, nous avons soif, nous sommes dans le dénuement, maltraités, nous n’avons pas de domicile, nous travaillons péniblement de nos mains. On nous insulte, nous bénissons. On nous persécute, nous le supportons. On nous calomnie, nous réconfortons. Jusqu’à présent, nous sommes pour ainsi dire l’ordure du monde, le rebut de l’Humanité. Je ne vous écris pas cela pour vous faire honte, mais pour vous reprendre comme mes enfants bien-aimés. Car, dans le Christ, vous pourriez avoir dix mille guides, vous n’avez pas plusieurs pères : par l’annonce de l’Évangile, c’est moi qui vous ai donné la vie dans le Christ Jésus. Aussi, je vous en prie : imitez-moi » (1 Co 4, 9-16). Paul estime avoir engendré ses disciples dans le Christ Jésus ; son ministère n’a pas été seulement une œuvre de persuasion, ni même un engagement exclusif pour améliorer les conditions de vie des personnes auxquelles il avait été envoyé, mais il s’est caractérisé comme un « engendrement à la foi », avec toute la participation intime que cela implique.
Au cours de la brillante histoire de l’évangélisation, combien d’exemples trouve-t-on d’hommes et de femmes qui ont vécu ainsi, à ce niveau de profondeur, et qui ont été féconds pour cette raison ! Souvent, le monde ne les a remarqués qu’après leur mort, mais leur sacrifice a contribué à faire germer silencieusement et efficacement la graine de l’Évangile dans de nombreux pays, même au milieu des luttes et des persécutions. En ces temps si incertains et chargés de nuages épais de haine entre les peuples, il vaut la peine de rappeler l’exemple du bienheureux Pierre Claverie, o.p., évêque d’Oran (Algérie), martyr. Dans une interview accordée/une homélie peu de temps avant l’attentat qui l’a tué avec son ami musulman Mohamed, il avait utilisé ces mots dans une homélie pour décrire la mission de l’Église en Algérie : « Où est notre maison ? Nous sommes là grâce à ce Messie crucifié. Pour aucune autre raison, pour aucune autre personne ! Nous n’avons aucun intérêt à défendre, aucune influence à maintenir… Nous n’avons aucun pouvoir, mais nous sommes là comme au chevet d’un ami, d’un frère malade, en silence, lui tenant la main, lui essuyant le front. À cause de Jésus, car c’est lui qui souffre, dans cette violence qui n’épargne personne, crucifié à nouveau dans la chair de milliers d’innocents. […] Où devrait être l’Église de Jésus, qui est elle-même le Corps du Christ, si ce n’est d’abord là ? Je crois qu’elle est en train de mourir précisément parce qu’elle n’est pas assez proche de la croix de Jésus… L’Église se trompe et trompe le monde lorsqu’elle se présente comme une puissance parmi d’autres, comme une organisation, même humanitaire, ou comme un mouvement évangélique spectaculaire. Elle peut briller, mais elle ne brûle pas du feu de l’amour de Dieu ».
Que l’intercession du bienheureux Claverie et des innombrables témoins de l’Évangile sur tous les continents nous confirme dans notre vocation missionnaire ad gentes, en la faisant renaître à notre époque.
* Traduction de l’italien au français par l’agence Fides.
** Promu par le Dicastère pour l’Évangélisation (Section pour la première évangélisation et les nouvelles Églises particulières) et par les Œuvres pontificales missionnaires.
(Photo: José I. Sierra)
Infolettre
Abonnez-vous à notre infolettre pour recevoir les toutes dernières nouvelles de nos Œuvres! Billets de blogue, nouvelles, vidéos et contenus exclusifs vous attendent à chaque mois!
Soutenez Mission foi
Contribuez au développement de l'Église en terre de mission, et apportez l'espoir du Christ aux plus démunis.
Faire un don